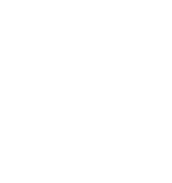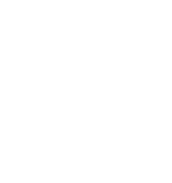Souvenirs d’un Parcours
Préambule
Entre la danse et moi, cela s’est passé comme dans un couple.
Un couple qui, après plusieurs décennies de vie commune, ne tient plus que grâce à une connaissance intime de l’autre et à une connivence devenue indéfectible. Un couple qui, malgré les conflits — internes comme externes — traversés au fil des années, ne parvient pas à envisager une rupture définitive.
Elle a pourtant eu lieu.
En 2002.
L’année où tout a basculé.
Danseur puis chorégraphe, usé par quarante-cinq années de danse, dont trente de carrière professionnelle, j’ai tourné la page pour me consacrer au patrimoine immobilier familial. Tous les artistes n’ont pas cette chance de reconversion.
En fin de parcours, beaucoup deviennent enseignants, avec plus ou moins de conviction, plus ou moins de talent.
Pour ma part, je suis devenu immobile…
Chapitre 1 : Comment est-ce arrivé ?
La danse est entrée dans ma vie par hasard.
En 1964, à une époque où les préjugés étaient encore tenaces, surtout lorsqu’un jeune garçon s’aventurait dans un art jugé délicat, voire efféminé. Il suffisait alors de prononcer le mot danse pour être mis au ban des cours de récréation.
J’avais neuf ans. Ma mère, elle, avait de la suite dans les idées. Elle me trouvait trop maigre, un peu voûté, pas vraiment taillé pour les sports virils censés faire un garçon.
Un jour, alors que j’observais, médusé, le cours de danse classique de ma sœur — en sueur, les joues rougies par l’effort — le professeur s’approcha du banc des visiteurs.
C’était un Catalan ténébreux, autoritaire, au regard à la fois séducteur et intimidant. Ce qui me fascinait le plus chez lui, c’étaient ses énormes sourcils broussailleux. À ma grande surprise, il s’adressa à moi :
— Alors, jeune homme… ça ne te dirait pas d’essayer aussi ?

L’école manquait cruellement de garçons. Je restai sans voix. Ma mère, elle, répondit à ma place, avec le plus grand naturel :
— Pourquoi pas ?
Sur le chemin du retour, je me demandais ce qui avait bien pu lui passer par la tête.
— La danse, c’est pour les filles ! protestai-je.
— Mais non… et puis ça te fera du bien.
Fin de la discussion.
Une semaine plus tard, me voilà dans le petit studio d’une école de danse encore peu connue à l’époque, mais qui deviendrait, des années plus tard, l’une des plus réputées au monde.
Un autre petit garçon avait été enrôlé lui aussi : Sébastien.
Le dur apprentissage des bases du métier de danseur nous était dispensé par ce même professeur aux sourcils impressionnants. Monsieur José.
Dans ce petit studio, il mettait tout son cœur. Pensez donc : en dehors des grands, Sébastien et moi étions, en 1964, les seuls garçons parmi plus d’une centaine de filles. L’école n’avait que deux ans d’existence. Il nous couvait.
Sa patience et sa dévotion finirent par nous conquérir. Nous nous appliquions à ne pas le décevoir.
Bien sûr, pas un mot à mes camarades de collège. C’était top secret. Mais, paradoxalement, j’attendais avec une impatience croissante mes cours hebdomadaires du jeudi et du samedi.
— Ce n’est pas des pieds que tu as, mon bonhomme… c’est des peaux de banane ! me lançait-il.
Cours après cours, malgré mes fameuses peaux de banane, je m’accrochais.
L’autorité de Monsieur José était aussi affectueuse qu’impressionnante. Il nous accordait tant d’attention que l’idée même de le décevoir nous aurait rendus malades.
Entre-temps, ma sœur avait déclaré forfait. La danse n’était pas son élément.
Un jour, Monsieur José nous annonça, l’air faussement détaché :
— Bon, mes cocos… maintenant, vous allez monter au grand studio avec les filles. Les cours particuliers, c’est fini.
Panique.
Nous nous regardâmes, Sébastien et moi, pétrifiés. Même effroi, même pensée muette : On est morts.
Être projetés tous les deux, seuls garçons, au milieu d’une trentaine de filles survoltées, prêtes — pensions-nous — à se moquer de nous sans pitié. Une trahison.
La montée des marches vers le grand studio se fit au forceps.
Mais, après avoir gloussé, gazouillé, minaudé, les filles s’habituèrent à notre présence. Peu à peu, nous parvînmes même à nous imposer comme des « hommes » — dans ce que nos camarades de collège, férus de football et de handball, appelaient avec mépris une discipline de gonzesses.
Tels des coqs au milieu du poulailler, nous avions très vite compris l’avantage que nous conférait ce statut rarissime de danseur mâle.
C’était Mademoiselle Arlette qui avait la charge des cours de débutants.
Un personnage haut en couleur, au physique comme au caractère imposants. Sa voix, amplifiée par la réverbération du grand studio de la résidence Montfleury à Cannes, était si puissante que tout le quartier savait exactement à quelle heure elle donnait ses cours.
Arlette ne faisait pas dans la demi-mesure.
Elle nous formait, nous façonnait, avant de nous laisser accéder aux classes supérieures. Elle n’enseignait pas la danse classique. Elle enseignait la danse. Point barre.
À ses débuts, elle ne se contentait pas de transmettre l’héritage de ses illustres professeurs russes et français qu’elle vénérait. Elle était même allée jusqu’au Danemark pour s’imprégner du savoir-faire de l’école Bournonville, célèbre pour sa maîtrise technique du bas de jambe.
Rien ne lui échappait. Tout devait servir le mouvement, la musicalité, l’intention.
Ses chorégraphies d’examen étaient de pures merveilles de sensibilité et de raffinement. Sa connaissance du répertoire classique semblait infinie. Avec elle, nous apprenions sans vraiment nous en rendre compte que la danse n’était pas qu’une affaire de pas, mais une manière d’habiter le monde.
Quelques années plus tard, l’idée même de concilier études et pratique artistique intensive commençait à peine à émerger dans les esprits des fonctionnaires du ministère de l’Éducation nationale.
Un accord précurseur fut alors établi avec le collège le plus proche afin de permettre des horaires aménagés. Dans les années soixante et soixante-dix, notre école était déjà en avance sur son temps.

C’est ainsi que je pus quitter avec soulagement ce que j’appelais mon bagne : le lycée catholique Fénelon à Grasse, pour intégrer l’établissement, tout aussi catholique mais nettement moins rigide, Sainte-Marie de Cannes, situé à deux pas du Centre de danse.
Mes parents, compréhensifs et tolérants, y trouvèrent une bonne conscience rassurante : je poursuivais des études normales tout en m’adonnant à ma passion.
Le problème, c’est que cette passion prit rapidement toute la place.
Fasciné par ma nouvelle vocation et par la découverte toute fraîche de la comédie musicale américaine, je décidai un jour de ne pas me présenter à l’examen du Brevet.
Danser sous une pluie battante sur Singing in the Rain, dans les collines du Super Cannes, entouré de quelques copines euphoriques, me paraissait infiniment plus jouissif.
Mon père, qui ignorait tout de Gene Kelly, goûta modérément à cette décision. Pourtant, les réprimandes sévères auxquelles je m’attendais ne vinrent jamais.
À ma grande surprise, il n’y eut aucune sanction.
Peut-être s’était-il dit, à cette époque, qu’après tout il avait un fils artiste, et qu’il allait bien falloir s’y faire.
Son fils aîné suivait son chemin dans la gestion et les travaux publics. Sa fille intégrait une école d’hôtesse de l’air. Pourquoi s’inquiéter si le dernier sortait un peu des sentiers battus ?
Un peu…
L’époque était particulière.
Je nageais avec bonheur dans l’insouciance de la fin des années soixante. Je ne touchais à aucune substance illicite, mais j’arborais un magnifique manteau en peau de mouton descendant jusqu’aux chevilles, de très longs cheveux bouclés, j’écoutais Bob Dylan sans le comprendre et je sillonnais la région sur une mobylette grise dernier cri, fleurie d’autocollants Peace and Love.
La mère de mon camarade Sébastien finit par déclarer forfait.
Elle ne voulait plus l’accompagner aux cours. Trop loin, trop contraignant, ou peut-être simplement trop compliqué. C’était dommage. Sébastien était doué. Je reste convaincu que, si lui et sa mère avaient été plus motivés, il aurait pu faire une très belle carrière.
Quelques mois plus tard, un nouveau camarade fit son apparition : Marc.
Très doué lui aussi, avec une bonne bouille et un charme indéniable, il trouva très vite sa place au sein de l’école. Sa coupe de cheveux à la Stone et Charden séduisit rapidement la gent féminine — professeurs et élèves confondus.
Il devint sans peine l’un des chouchous.
Marc baignait déjà pleinement dans l’idéologie soixante-huitarde.
Il fumait des pétards avec le professeur de danse moderne californien fraîchement recruté, séduisait sa femme complètement déjantée et parlait, dès cette époque, d’écologie.
Il était libre, insolent, imprévisible.
Il fut longtemps un concurrent redoutable dans mes conquêtes féminines au sein de l’école.
Un jour pourtant, Marc décida de s’exiler à la montagne pour y vivre l’expérience d’un berger, au plus près de la nature. C’était dans l’air du temps.
Il partit sur un coup de tête, au grand désespoir de notre maître, Monsieur José.
On ne le revit plus pendant de longues semaines.
Puis il réapparut, comme si de rien n’était.
— Tu sens mauvais ! Tu sens le bouc à cent mètres ! lui lança Monsieur José.
C’était vrai. Il sentait vraiment très fort.
— J’ai réfléchi… répondit simplement Marc.
Après s’être refait une fraîcheur, il reprit les cours comme si rien ne s’était passé.
C’était tout lui.
Considéré comme l’un des meilleurs espoirs masculins de sa génération à l’école, ses idées très personnelles et revendicatives l’amenèrent plus tard vers une carrière que personne n’aurait prédite : la danse baroque.
C’est là qu’il trouva sa voie, après de nombreuses péripéties, refusant obstinément de se laisser orienter vers une carrière de danseur classique trop bourgeoise à ses yeux.
Il s’accrocha d’abord à une personnalité hors normes, tout aussi rebelle que lui : Jean Babilée, fraîchement nommé à la tête du Ballet du Rhin.
Les deux n’y restèrent qu’une saison. Incapables de se plier au conformisme artistique et institutionnel qui régnait dans ce milieu. Des insoumis.
Lorsque j’avais découvert Babilée à la télévision en noir et blanc, bien des années plus tôt, c’est lui qui m’avait donné envie de me consacrer à la danse.
Résistant, danseur, artiste libre : tout, chez lui, m’avait fasciné.
Marc et lui étaient faits pour se rencontrer.
Chorégraphe et directeur de compagnie à Marseille une vingtaine d’années plus tard, Roland Petit deviendrait pour moi l’objet de mes premiers tourments de jeune danseur professionnel.
À dix-sept ans, je me retrouvai engagé dans une compagnie de danse classique, propulsé trop vite dans un monde pour lequel je n’étais pas préparé.
Ce qui devait être un accomplissement se révéla être un choc brutal.
Je vécus alors un désarroi étrangement proche de celui de Marc.
Lui aussi se retrouva largué, en décalage total avec un univers où régnaient une compétition aussi agressive que stérile, des jeux de pouvoir mesquins, une violence sourde et méprisante.
Ni lui ni moi n’irions jusqu’au bout de nos premiers contrats respectifs.
Nous étions seuls. Dépités. Déboussolés.
Ce monde professionnel, que nous avions idéalisé, nous apparaissait soudain sous un jour cruel. Il ne s’agissait plus de danser, mais de survivre. De se comparer. De se battre pour une place, parfois au mépris de toute humanité.
Après cet échec, nous sommes retournés, chacun de notre côté, à la case départ : notre école.

Elle n’était pas un centre de formation académique au sens strict, mais un lieu où éclosaient des personnalités. Un refuge aussi.
Nous y retrouvions un nouvel élan, un souffle différent, après ce faux départ.
Malgré sa rudesse, cette première épreuve marseillaise m’a tout de même offert quelques instants de grâce, de véritables moments de bonheur. Des éclairs. Insuffisants pour rester, mais suffisants pour ne pas renoncer.
Ce chapitre de ma vie se referma ainsi :
entre l’innocence d’un hasard et la violence d’un réveil.
La suite restait à écrire.
Chapitre 2 : Une école hors normes
Lorsque Monsieur José convainquit ma mère de me mettre à la danse, elle était loin d’imaginer l’histoire du quintet aussi marginal que génial qui dirigeait alors cette école.
À sa tête se trouvait Rosella Hightower.
Une danseuse hallucinante, lumineuse. Née en Oklahoma, de sang indien, elle avait débarqué en France en 1938 pour rejoindre Léonide Massine au sein des Ballets Russes de Monte-Carlo. Elle poursuivit ensuite une carrière internationale exceptionnelle au sein de la compagnie du Marquis de Cuevas, dont elle fut longtemps l’égérie.
Vers la fin de cette carrière — qui, en réalité, était loin d’être terminée — elle décida de fonder une école de danse à Cannes. Non par lassitude, ni par reconversion, mais par fidélité à un rêve ancien. Comme sa fille me le confiera bien plus tard, Rosella voulait créer cette école depuis l’âge de dix-huit ans.
Elle s’entoura de ses amis les plus proches :
Monsieur José, Mademoiselle Arlette, d’autres danseurs issus du Ballet du Marquis de Cuevas, un musicien hors pair, et son mari, peintre et costumier.
Un groupe de doux fous furieux.
Bourrés de talent, aussi bien artistiquement que pédagogiquement. Leur enseignement n’était pas académique au sens strict : il était instinctif, viscéral, profondément humain.
Je me retrouvai ainsi plongé sous l’influence de ces personnages aussi hypnotiques qu’improbables, qui s’avérèrent être des professeurs d’exception. Pas seulement en danse.
Claude Potier, qui accompagnait les cours au piano, était un musicien merveilleux.
Élève de l’élève de Maurice Ravel, il avait hérité du piano même du compositeur, qui trônait majestueusement dans la grande salle de danse. Sa mission n’était pas seulement de jouer, mais de nous enseigner la musique, son histoire et de nous y sensibiliser.
Aucune école de danse de l’époque ne faisait cela.
Dans mon cursus figuraient des cours d’analyse musicale, de solfège, de rythme. Claude réunissait également certains élèves pour former une chorale autour de ses propres compositions, d’une délicatesse impressionniste bouleversante.
Nous étions subjugués. La chair de poule nous gagnait à chaque répétition.
Il fallait une sacrée patience pour composer avec ces voix de filles incertaines et de garçons en pleine mue. Et pourtant, c’était grandiose. Les élèves eux-mêmes n’arrivaient pas à croire qu’une chose aussi belle puisse sortir de leurs gosiers pubères et mutants.
Lorsqu’il accompagnait Rosella au piano pendant les cours, nous n’avions qu’une envie : lâcher la barre, nous asseoir par terre et écouter. Ce n’était plus un cours de danse, mais un concert.
Je me demandais souvent pourquoi j’avais droit à un tel trésor de savoir.
Après tout, je n’étais là que pour apprendre à devenir danseur…
J’ignorais encore que cette éducation musicale serait plus tard un atout majeur dans ma carrière, d’abord comme interprète, puis comme chorégraphe. Elle me vaudrait même, dans certaines compagnies, le qualificatif de danseur musical — celui qui n’a pas besoin de compter sur ses doigts pour être juste. L’inverse du redoutable sobriquet de danseur sourd. Et ils étaient nombreux…
Dans les disciplines parallèles enseignées dans cette école unique, il y avait aussi Jean Robier, le mari de Rosella.
Il nous enseignait le dessin.
Le dessin ?
À quoi bon, lorsqu’on veut devenir danseur ?
La réponse est simple : comment prendre conscience de son corps lorsqu’on est incapable de se le représenter dans l’espace ?
Dessiner un geste, un volume, une projection, permettait de mieux le comprendre ensuite avec le corps. Comme Claude refusait que les élèves soient sourds, Jean refusait qu’ils soient aveugles. Il nous apprenait à nous percevoir en trois dimensions.
Il y avait aussi Anne Ker, extraordinaire professeure de mime.
Dans cette école, tous les sens étaient sollicités.
Pendant ce temps, Rosella Hightower poursuivait sa carrière internationale sous nos yeux. Elle restait en contact avec les plus grands danseurs, chorégraphes et directeurs de compagnies. Des monstres sacrés. Des idoles.
Ils répétaient parfois dans les mêmes studios que nous.
Nous avions même le privilège d’assister à certaines représentations.
Je me souviens particulièrement d’un déplacement à Marseille pour voir Rosella danser avec Noureev. L’école avait affrété un bus. Les places réservées se trouvaient au poulailler du théâtre — les plus hautes, les plus éloignées.
Nous n’étions pas des poules.
Nous étions des anges au paradis.
Nous hurlions notre admiration à chaque salut, comme des supporters de football. Nos cris n’avaient rien à envier à ceux du Vélodrome.
Bien plus tard, alors que je poursuivais ma carrière, Monsieur José partit à la retraite.
Ce fut comme si une partie de l’âme de l’école s’en allait avec lui.
Un dernier cours fut organisé avec ses plus anciens élèves devenus professeurs à leur tour ou chorégraphes.
Il est de bon ton de dire que personne n’est irremplaçable.
À ce proverbe dangereux et paresseux, je répondrai ceci : tout le monde est unique. Ou tente de l’être.
Je fus probablement le dernier élève à lui rendre visite de son vivant, à Barcelone. Il semblait heureux, mais je percevais chez lui une appréhension sourde face à l’inactivité et à la solitude. Sa fierté et sa dignité étaient atteintes.
C’est peut-être cela qui l’a tué.
Sinon la cause, du moins un facteur aggravant.
Un de ceux dont on ne tient jamais assez compte.
Chapitre 3 : L’aventure marseillaise
À partir des années soixante-dix, Rosella Hightower prit également la direction de la danse dans plusieurs grandes maisons : Marseille, Nancy, l’Opéra de Paris, la Scala de Milan, tout en gardant une présence et un œil vigilant sur son école cannoise.
Quelques années après avoir pris la tête du Ballet de l’Opéra de Marseille, elle estima que le moment était venu pour moi d’entrer dans le monde professionnel. J’avais dix-sept ans.
N’étant pas majeur, ce fut mon père qui signa mon tout premier contrat.

Le contexte n’était pas idéal.
Le Ballet de l’Opéra de Marseille déclinait depuis l’arrivée fracassante de Roland Petit, qui s’était approprié l’essentiel des financements municipaux pour implanter sa propre compagnie. La ville n’avait plus d’yeux que pour lui.
Rosella finit par céder sa place à un jeune maître de ballet cubain qui tenta de maintenir une troupe digne de ce nom. Pour moi, c’était du bonus. Ce contrat me permettait d’apprendre les bases du métier, de mettre enfin un pied dans la réalité du métier.
Je travaillais comme un forcené.
Roland Petit, en manque d’effectifs, avait engagé quelques danseurs de l’Opéra en renfort pour ses nouvelles productions. J’en faisais partie.
Mes journées commençaient à neuf heures à l’Opéra pour le cours quotidien et les répétitions d’opérettes jusqu’à treize heures. Puis reprise à quatorze heures, direction le studio de la compagnie Roland Petit, jusqu’à dix-neuf heures.
Le soir, je rentrais vidé.
Lessivé par l’apprentissage incessant de pas, de variations, d’informations en cascade. J’avançais en pilote automatique.
Heureusement, il y avait Claudie Winzer.
Danseuse chevronnée, chargée de former les nouvelles recrues au répertoire. Une sorte de Mère Teresa de la danse, dotée d’une patience angélique. Sans elle, nous n’aurions jamais tenu.
Après plusieurs semaines à ce régime, je ne savais plus très bien qui j’étais.
Je rentrais dans ma piaule au radar, avalais n’importe quoi, puis m’abandonnais aux bras de Morphée sans demander mon reste.
Dans la troupe, il y avait Gian Marco, un danseur italien dandy.
Pas le meilleur techniquement, mais toujours tiré à quatre épingles. Une revue de mode ambulante. À l’époque, c’était rare chez les danseurs, qui avaient plutôt tendance à se laisser aller côté vestimentaire.
Quand Gian Marco arrivait le matin aux vestiaires, on avait l’impression qu’il allait se marier dans la journée.
Un jour, en vue de la tournée parisienne, je décidai de m’offrir un costume élégant. Je soumis mon choix à son œil expert. Sa réaction fut immédiate :
— Brouno ! Lé costoume il est pas mal… mais si tou n’as pas lé chaussoures qui vont avec, c’est pas la peine ! C’est la chaussoure qui fait lé costoume !
Il avait raison.
Mes chaussures étaient épuisées. Et orange sale. Ce qui à l’époque était plutôt « tendance » était, pour lui, une faute de goût indéniable.
Côté cœur, mes aventures se limitaient à une relation avec une danseuse de la compagnie. Plus âgée que moi, elle me traitait comme un jouet. Me faisait miroiter monts et merveilles tout en se moquant de ma naïveté.
Un soir, complétement déprimé, je m’arrêtai devant la vitrine d’un marchand d’animaux près de chez moi. Sans réfléchir, j’achetai un chiot.
J’avais besoin de chaleur. Faute de chaleur humaine, je me rabattis sur la chaleur animale.
Je ne me souviens ni du nom de la fille, ni de celui du chiot.
Aucun regret pour la première. Beaucoup pour le second.
Mal nourri, mal soigné par le vendeur et victime de mon immaturité et de mon manque de temps, il tomba malade. Et quand je partis en tournée pour un mois à Paris, je n’avais prévu aucune solution.
La seule qui me vint à l’esprit :
Allô maman bobo…
Mes parents vinrent le récupérer. Quelques semaines plus tard, ils durent le faire piquer. Galle, complications, aucune chance de survie.
Ce fut ma seule expérience avec les chiens.
Par la suite, ce sont les chats qui ont partagé ma vie. Comme beaucoup de danseurs. Leur manière de bouger, leur maîtrise du corps et de l’espace en font des compagnons naturels.
La tournée parisienne fut intense.
Je gagnais mal ma vie, mais danser à dix-huit ans sur scène avec les Pink Floyd, en live, ça marque une existence. Assister à un duo entre le batteur Nick Mason et le sublime danseur Rudy Brians valait tous les cachets du monde.
À mesure que les anciens tombaient blessés ou épuisés, je remontais dans les rangs.
Du fond du corps de ballet jusqu’aux premières lignes, tout près du public.
Une place pas forcément enviable.
À Paris, le public huait et sifflait quand nous nous installions sur scène. Il venait pour les Pink Floyd, pas pour voir des danseurs en train de s’agiter devant eux en collants blancs et moule-burnes. À Marseille, lors de la première au Gymnase, un danseur qui était loin d’être une chochotte, descendit de scène et commença à castagner un jeune kakou qui lui avait lancé une canette à la tête. La bagarre générale ne fut évitée que de justesse.
Un soir avant le spectacle, dans les vestiaires, une ligne de coke et une coupe de champagne me furent proposées par l’un des musiciens des Pink Floyd. Je déclinai malgré l’immense admiration que j’avais pour le groupe.
Après le spectacle je me suis retrouvé avec un ami à l’arrière de la Rolls d’un grand PDG de la haute couture pour nous rendre dans les folles soirées parisiennes de la boîte de nuit de Régine. C’était l’air du temps mais je n’avais aucune envie de ce que m’offrait cette vie parisienne-là.
Après un mois d’épuisement total, je retrouvai ma piaule marseillaise. Et une plaque de cuisson carbonisée que j’avais oublié d’éteindre avant mon départ.
Toujours sous contrat avec l’Opéra de Marseille, je n’avais plus grand-chose à faire d’intéressant. J’étais vidé. Sans perspectives.
Une idée s’imposa : rentrer au bercail.
Lorsque je passai récupérer quelques affaires au Ballet de Roland Petit, je jetai un dernier regard au studio. Roland faisait un point sur l’avenir de la compagnie.
— Et Bruno ? Il est où ?
— Il est là ! lança un assistant en me désignant.
Pris au piège, j’entrai.
— Que veux-tu faire maintenant ?
— Je ne sais pas…
— Tu veux entrer dans la compagnie ?
Derrière moi, les danseurs murmuraient :
— Non… casse-toi…
— Non.
— Pourquoi non ?
— Je ne suis pas prêt.
— Pas prêt ?!
— Je veux retourner à l’école.
Il me congédia d’un geste sec.
Le lendemain, je démissionnai de l’Opéra de Marseille, fis, avec bonne humeur et sans regrets mes valises. Je pris le premier train pour la maison.
Avec le recul, si Roland Petit a pu signer des œuvres tout à fait respectables à ses débuts, son talent s’est peu à peu émoussé avec les années.
Dans les années soixante-dix, il donnait une apparence de légitimité à ses ballets en invitant de grandes figures comme Maïa Plissetskaïa ou en multipliant les coups médiatiques, notamment en s’associant à des groupes de rock célèbres.
Il disposait pourtant de danseurs remarquables — Denis Ganyo, Rudy Brians, entre autres — mais les chorégraphies qu’il leur confiait se révélaient souvent fades, noyées sous une esbroufe médiatique savamment orchestrée, agrémentée de paillettes parisiennes et de mondanités.
Plus tôt dans sa carrière, Roland Petit avait dans sa troupe parisienne un danseur nommé José Ferran — mon professeur aux sourcils broussailleux — qui faisait office de doublure.
Lorsque le maître n’avait pas envie de danser, notamment dans des villes jugées secondaires comme Saint-Étienne ou Limoges, c’était José qui montait sur scène, souvent avec un talent égal, voire supérieur.
Lors d’une tournée en Espagne, la compagnie fit halte à Barcelone, ville natale de José. L’occasion aurait été idéale pour lui de danser devant les siens. Roland Petit refusa.
Motif : ville trop importante.
Quelle générosité. Quelle grandeur d’âme.
À mes yeux, Roland Petit ne doit sa place dans l’histoire de la danse française qu’au contexte exceptionnel d’une époque artistique foisonnante. Il a su s’entourer de peintres, de stylistes et de compositeurs de renom, qui ont contribué à nourrir son image et à masquer bien des faiblesses.
Beaucoup, des solistes sûrement, témoigneront à juste titre de « l’extraordinaire expérience » vécue à ses côtés.
Pour ma part, le souvenir que je garde de Roland Petit, en tant que jeune artiste comme en tant qu’homme, est celui d’un personnage méprisant pour « les « artistes/ouvriers » de la danse.
Chapitre 4 : Retour au bercail
Après tous ces déboires, quel bonheur de retrouver la chaleur familiale.
Ma chambre. Mon école de danse. Et surtout ces professeurs pour lesquels j’avais tant d’admiration.
Quel soulagement de redevenir un adolescent presque normal, après avoir tenté, trop tôt, de jouer à l’adulte.
Après la détresse sentimentale, les désillusions professionnelles, l’insécurité permanente.
Retrouver la sécurité.
L’attention.
L’amour.
Redevenir l’objet d’intérêt d’une famille et d’une école où les plus jeunes vous regardent soudain avec admiration, parce que vous avez connu le monde professionnel dont ils rêvent encore. Cette place-là faisait du bien. Elle réparait.
Nous étions en pleine période estivale.
L’école bourdonnait. Les cours étaient pleins à craquer. Des professeurs invités se succédaient, mais Arlette, Rosella et José continuaient, fidèles au poste, à faire vivre l’âme du lieu.
Des danseurs professionnels internationaux conciliaient vacances au soleil et maintien de la forme. Des échanges avec des écoles du monde entier animaient l’été. Une richesse humaine et artistique incroyable.
C’est cet été-là que je fis la connaissance d’Ilka.
Une danseuse américaine hors norme, venue avec quelques élèves de son école de San Diego. Ilka mesurait un mètre quatre-vingt-dix. Je faisais cinq centimètres de moins, et je n’avais pas l’habitude de regarder mes conquêtes féminines d’en bas.
Mais elle était belle comme un astre, d’une douceur infinie. Je tombai immédiatement amoureux.
J’avais encore ma mobylette.
Quand nous allions à la plage ou ailleurs, elle devait se coller à moi en retenant ses jambes interminables par les chevilles pour éviter qu’elles ne traînent par terre. Un exercice périlleux, mais joyeux.
Faute de moyens pour les discothèques, nous nous retrouvions sur la petite plage derrière le Casino Palm Beach, profitant gratuitement de la musique, nous offrant des bains de minuit.
On l’appelait « la belle Américaine ».
Sa taille fut pourtant un lourd handicap pour sa carrière.
Engagée à Hambourg puis à Francfort, elle se retrouvait systématiquement reléguée au dernier rang du corps de ballet. Alors, forte de sa créativité, elle tenta une carrière de danseuse solo, se mit à la chorégraphie, présenta des spectacles à Cologne, Francfort, Paris.
J’ai toujours gardé pour elle une immense tendresse.
Aujourd’hui, elle dirige avec succès une école de danse aux États-Unis, mariée à un baryton américain rencontré en Allemagne.
C’est d’ailleurs frappant : combien de danseuses de mon entourage ont épousé des chanteurs d’opéra ou des musiciens… Peut-être une question d’oreille et de sensibilité partagée.
À la même période, j’ai connu l’exact opposé.
Après la grande Américaine, il y eut Laura, une petite Espagnole vive et lumineuse.
Laura, elle, n’avait pas besoin de se tenir les chevilles sur la mobylette.
Elle mesurait un mètre soixante, talons compris.
« Laura, te quiero ! » lui criais-je en traversant Cannes à toute allure.
Notre relation fut tendre, maladroite, initiatique.
Elle vivait tout avec une intensité sérieuse qui m’échappait encore. J’étais insouciant, léger, incapable d’anticiper les conséquences émotionnelles de mes gestes.
Quand ses parents vinrent lui rendre visite au Centre, je ne compris pas l’importance que cet événement avait pour elle. Elle me voyait déjà autrement. Peut-être comme un futur mari, qui sait.
Pour moi, je n’étais que le copain du moment.
La confrontation entre mon insouciance et le poids des traditions familiales espagnoles ne lui laissa guère le choix. Notre couple n’y résista pas.
Pendant ce temps, Rosella avait quitté le navire en perdition qu’était devenu le Ballet de l’Opéra de Marseille.
L’Opéra de Nancy lui proposa de créer une compagnie de danse digne de ce nom.
Elle accepta.
Et une fois encore, elle me prit dans ses bagages.
Je suis certain que son objectif, au fond, était toujours le même :
placer les danseurs qu’elle avait formés. Leur ouvrir des chemins. Leur éviter de se perdre.
Chapitre 5 : Nancy
Laura fit partie du lot de danseurs recrutés pour l’aventure. C’est d’ailleurs à Nancy qu’elle trouva l’homme de ses rêves — un chanteur, bien évidemment — avec qui elle fonda une famille nombreuse. Enfin… je crois.
Je refis mes malles, en me jurant que, fort de l’expérience marseillaise, je ne referais pas les mêmes erreurs.
L’expérience fut, en effet, très différente. Rosella tentait de créer une compagnie de danse classique digne de ce nom en remontant les grands ballets du répertoire. Le niveau des danseurs n’était pas, au début, réellement au top. La troupe ressemblait à un patchwork de nationalités, de techniques et de tempéraments. Une mosaïque riche, mais sans homogénéité — à l’image des élèves de son école.
Pour les rôles principaux, Rosella faisait venir des danseurs étoiles qu’elle avait formés auparavant, afin de donner un peu de lustre et de tenue à cette troupe aussi improbable qu’attachante. Elle fit ce qu’elle put. Et elle tint deux ans dans cette aventure héroïque.
Il faut dire qu’à l’époque, les danseurs étaient payés au lance-pierre. Nous étions dans l’archétype du fonctionnement d’un opéra municipal de province.
J’ai conservé un bulletin de salaire de ces années-là : une bande de papier d’un centimètre de hauteur sur quinze de largeur. Y figuraient les charges salariales, patronales, le brut… et le fameux « net à payer ».
Inutile de préciser que ce net vous condamnait à manger des pâtes ou des lentilles jusqu’à la fin du mois.
Un jour, alors que nous faisions la queue devant le bureau du chef comptable — un véritable rond-de-cuir — je l’entendis lancer à une collègue danseuse, sur un ton méprisant :
« Oh ! Vous gagnez tout ça… pour faire… »
Il se mit alors à agiter les bras dans tous les sens :
« …pour faire ça ?! »
Ma camarade, sidérée, n’osa pas répondre.
Cet homme était resté mentalement au XIXᵉ siècle, à une époque où la danseuse vivait sous la tutelle financière d’un bourgeois local. Nous étions pourtant en 1972. Pas un siècle plus tôt.
Les fonctionnaires des opéras municipaux étaient assujettit aux mêmes règles les mêmes que celles des autres services municipaux. Ils travaillaient à l’opéra de la même manière que ceux qui travaillaient à l’état civil ou au espaces verts.
Que ce vieux gratte-papier, qui ne savait pas ce qu’avait enduré ma collègue pour obtenir cette place de danseuse à l’opéra de Nancy, se permette de lui faire des remarques sur son salaire qu’il jugeait immérité m’a probablement marqué à vie.
J’écoutais Jacques Brel et Léo Férré. Cette remarque est restée gravée en moi et a probablement orienté durablement mes idées politiques.
L’institution entière baignait dans cette mentalité. Le directeur de l’opéra aimait organiser, dans ses appartements de fonction, des soirées « olé-olé » réunissant jeunes divas et quelques danseuses peu farouches. Cela alimentait cet état d’esprit général.
Malgré nos salaires misérables, nous menions pourtant une vie débridée. Nous compensions en faisant la fête sans cesse.
En dehors de la production chorégraphique annuelle — une par saison — nous assurions surtout les divertissements dans les opéras et les opérettes. De courtes interventions noyées dans des spectacles interminables.
Entre deux actes, en costume bien sûr, il nous arrivait d’aller boire un verre au Bar de l’Opéra, juste en face de l’entrée des artistes. Un savant calcul de minutage nous permettait de rentrer sur scène sans nous faire attraper par le régisseur.
Parfois, nous avions un peu trop forcé sur l’alcool, et nos prestations n’étaient alors pas exactement exemplaires. Mais notre manque de rigueur était à la mesure du mépris que nous ressentions. Aucun regret. Nous buvions à la santé du chef comptable.
Un jour, nous découvrîmes qu’un chanteur soliste amateur n’était autre qu’un dentiste local, cumulant les revenus de ses couronnes et dentiers avec ses cachets à l’opéra. Protégé par le directeur et sans doute par les notables de la ville, il chantait mal, était ringard, prétentieux et méchant.
Nous décidâmes d’agir en défendant la cause de jeunes chanteurs talentueux que nous croisions parfois et qui ne trouvaient pas les emplois qu’ils auraient pourtant mérités.
Notre stratégie fut simple : nous installer au poulailler et manifester bruyamment notre désapprobation en destituant du statut d’artiste cet usurpateur qui s’en mettait plein les poches pendant que l’on se faisait traiter de saltimbanques minables par notre dédaigneux comptable.
Le soir venu, à la caisse, la caissière — ravie de notre intérêt soudain pour l’art lyrique — nous proposa des places restées vacantes à l’orchestre.
« Non, merci. On préfère voir d’en haut. »
Elle nous donna deux places au poulailler, non sans étonnement.
Incapables de siffler correctement par nos propres moyens, nous avions eu l’idée d’acheter deux « langues de belle-mère ». Ces sifflets, prolongés d’une bande de papier enroulée et fréquemment utilisés pour les fêtes en tout genre. Dépouillés de leurs bandes de papier, les langues de belle-mère devenaient d’horribles sifflets stridents. Nous avions en main notre arme fatale.
Il y avait peu de public au poulailler. Le spectacle était médiocre et nous attendions avec impatience, la peur au ventre, le moment décisif où nous allions intervenir.
Lorsque l’arracheur de dents entama son aria final qui, comme à l’accoutumée ne fût pas plus brillant que la veille, nous retenions notre souffle. À la fin, nous soufflâmes de toutes nos forces. Le vacarme fut immédiat. Toutes les têtes de l’orchestre se retournèrent vers nous.
Pétrifiés, plaqués contre nos sièges, nous attendions la sanction. Elle ne vint jamais. Nous avions bien évidemment constaté que les ouvreuses nous avaient repérés. Mais, fait extraordinaire, elles ne nous dénoncèrent jamais. Probablement acquises à notre cause, l’affaire fut étouffée. Le dentiste retourna à ses caries et ne fut plus jamais distribué.
C’était ça, Nancy.
Nous nous ennuyions tant que nous inventions des diversions : fêtes, patins à roulettes au parc de la Pépinière, canulars sur la place Stanislas, nuits plus ou moins éthyliques où chacun cherchait sa chacune sans conviction, à jouer au strip-poker jusqu’à l’aube. Une fois, après avoir perdu au jeu, je me retrouvai à faire le tour de mon immeuble entièrement nu, à trois heures du matin. Heureusement, la ville dormait. Enfin… je crois.
Jeunesse en perdition joviale mais en recherche d’un meilleur avenir.
Le lendemain matin, nous avions bien évidemment droit aux réprimandes qui s’imposaient pour nos retards aux répétitions sur le plateau de l’Opéra, à l’occasion de la énième mise en scène d’une énième opérette qui ne nous intéressait guère. Comme beaucoup d’autres, elle nous demandait uniquement de faire ce que l’on appelait pudiquement à l’époque des « entourages ».
Définition de l’entourage :
Il s’agissait de faire la « houlà houlà », avec moult gesticulations autour d’un chanteur soliste, dans le but de créer une décoration corporelle animée destinée à le mettre en valeur. On utilisait pour cela les corps de jolies danseuses (s’il s’agissait d’un chanteur) ou de beaux danseurs (s’il s’agissait d’une chanteuse), afin de pallier son manque chronique de sensualité et de mobilité.
Le plus pathétique, c’était lorsqu’ils s’évertuaient à faire quelques pas de danse avec nous. C’en était presque douloureux à regarder. Certains étaient adorables, et nous faisions alors tout notre possible pour que le décor soit impeccable. D’autres, généralement les plus médiocres, déversaient sur nous toute la mauvaise humeur que leur inspirait la réalité de leurs mobilités défaillantes.
Lorsqu’ils se plantaient vocalement en répétition, ils invoquaient avec la mauvaise foi la plus totale notre prétendue responsabilité, inventant des excuses du genre :
— Mais c’est parce qu’ils sont trop près de moi ! Ça me déconcentre…
Dans les opérettes, en général, notre présence était jugée indispensable. Toutes les parties dansées, qu’elles soient justifiées par le livret ou nécessaires à un changement de décor, avaient été écrites par le compositeur.
Avec des œuvres comme L’Auberge du Cheval-Blanc ou La Route Fleurie, nous étions bien plus sollicités pour « décorer » les chanteurs que pour nos éventuels talents de danseurs.
Il y avait toutefois des exceptions, notamment chez Offenbach, où nous avions enfin l’occasion de briller, de nous amuser et surtout de partager notre enthousiasme avec le public à travers de vraies chorégraphies portées par une belle musique. Ces passages représentaient de véritables défis, avec des changements de costumes en coulisses chronométrés à la seconde près.
Les techniciens du théâtre adoraient ces moments. Ils y trouvaient surtout l’occasion de reluquer les danseuses en tenue minimale, dans des mises en scène qui ne leur laissaient même pas le temps de regagner leurs loges pour se changer.
Le pire restait les opéras. Je ne parle pas d’œuvres comme Aïda, où un long passage est consacré au ballet, mais de celles où le compositeur s’était cru obligé d’ajouter un divertissement chorégraphique de cinq minutes au milieu d’un spectacle de trois heures.
Bien évidemment, ce passage tombait toujours en plein cœur de l’œuvre. Concrètement, cela signifiait pour nous plus de quatre heures passées au théâtre pour une intervention de cinq à dix minutes.
Les règles étaient immuables :
— arrivée au théâtre une heure avant la représentation, en cas de défaillance ou de remplacement imprévu ;
— attente interminable dans les loges avant notre passage (tricot, rami, etc);
— et, si le metteur en scène se montrait particulièrement vicieux, une ou deux heures supplémentaires pour assister aux saluts finaux.
L’horreur.
Les metteurs en scène contemporains ont depuis longtemps renoncé à ces interventions, qui ressemblaient davantage à une sollicitation lubrique des commanditaires qu’à une réelle nécessité dictée par le livret. À l’époque, il fallait sans doute occuper le corps de ballet dans des théâtres dont la vocation était avant tout lyrique et musicale.
La danse restait la cinquième roue de la charrette. La programmation en témoignait : opérettes, opéras, théâtre invité… et, pour la danse, le glorieux 1 % restant, toujours placé dans la période la plus ingrate de la saison.
À cette époque, les troupes de danse des opéras municipaux commençaient à disparaître. La musique régnait en maître, malgré les blasons gravés sur les frontons : Musique, Théâtre, Danse.
C’est ainsi que naquirent plus tard, sous Jack Lang, les centres chorégraphiques. Mais ceci est une autre histoire.
Au théâtre de Nancy, les soirs de spectacle, la présence d’un pompier était obligatoire. C’était souvent Roger qui s’y collait. Un brave type qui passait parfois la nuit entière endormi dans le renfoncement du cadre de scène, oublié après la chute du rideau.
Lors de nos escapades au Bar de l’Opéra, dans l’attente de notre intervention, Roger nous accompagnait souvent. Il fumait comme un pompier ses Gitanes maïs. Nous fumions autant que lui, comme beaucoup de danseurs de l’époque.
Nous regardions nos montres les uns après les autres en nous disant :
— Tiens, le deuxième acte se termine… encore vingt-trois minutes avant notre passage.
Nos discussions pouvaient s’éterniser jusqu’à plus soif, mais nos consciences professionnelles nous interdisaient le moindre retard.
Face au constat, établi avec stupeur, d’avoir tant travaillé pendant tant d’années pour devenir danseurs professionnels et de nous retrouver à faire de telles inepties, il nous arrivait de craquer et de laisser libre cours à nos délires et à nos fantasmes les plus improbables.
Nous nous vengions en inventant des divertissements ahurissants, histoire de prouver — au moins à nous-mêmes — que nos talents créatifs n’étaient pas exploités là où ils auraient dû l’être. Et lorsque l’inspiration artistique faisait défaut, nous nous tournions vers d’autres expériences, en multipliant nos explorations sensuelles et culinaires.
Nous nous invitions les uns chez les autres pour de bonnes bouffes et des parties de cartes. Les couples se faisaient et se défaisaient au fil des mois. Tout se déroulait dans une insouciance totale, dans une ambiance bon enfant. Le sida n’avait pas encore fait son apparition ; l’époque était plutôt cool…
Un soir, alors que je me retrouvai avec une nouvelle conquête, celle-ci me réserva une surprise inattendue : à chaque fois que nous faisions l’amour, elle s’évanouissait. En plein milieu de l’acte.
À ma grande stupéfaction, alors que nous étions en pleine action, elle tombait dans les pommes sans crier gare.
La première fois, j’eus une peur bleue. Je me disais : Merde, qu’est-ce que j’ai fait ?
Mais la deuxième, puis la troisième fois, je pris les dispositions qui s’imposaient en lui administrant quelques petites claques pour qu’elle se réveille et qu’on en finisse.
— Arrête de me foutre la trouille ou j’appelle les pompiers ! lui lançais-je avec autorité.
Elle se réveillait alors comme la Belle au bois dormant, revenant à la vie avec un grand sourire, m’assurant qu’elle ne savait absolument pas pourquoi cela lui arrivait.
Au bout d’un certain temps, lassé, je lui fis comprendre que je ne supportais plus ce que je considérais comme des pannes de retransmission en plein film à suspense et que je préférais en rester là. La rupture fut consentie.
Pour l’expérience culinaire, il y eut Sacha.
Sacha était un Russe immigré qui avait ouvert un tout petit restaurant à Nancy. Nous l’avions rapidement repéré et adopté comme « cantine » après nos représentations. La raison en était simple : il adorait le monde artistique et nous accueillait chez lui à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.
Je crois que le pauvre Sacha n’a jamais fait le moindre bénéfice avec nous. C’est plutôt nous qui lui devons encore de l’argent aujourd’hui ! Il avait même transformé son minuscule restaurant en cabaret.
Un jour, il nous présenta une famille américaine au grand complet qui traversait l’Europe avec son spectacle improbable. Ils étaient au moins six ou sept — je ne sais plus exactement. C’était tout simplement surréaliste : ça chantait, ça dansait. Trois générations, de huit à soixante-cinq ans, réunies sur scène.
Un spectacle bon enfant, sans prétention ni talent particulier. Une curiosité. Mais ils étaient si touchants que Sacha les avait accueillis dans son petit restaurant, où ils donnaient deux représentations chaque soir.
J’aimerais beaucoup retrouver Sacha aujourd’hui. Il a été comme un père pour moi.
Lorsque j’ai dû quitter le Ballet de l’Opéra de Nancy pour faire mon service militaire, il glissait dans mon sac, à chaque permission, un poulet rôti entier, des gâteaux et des fruits secs :
— Pour que tu ne meures pas de faim, me disait-il…
Où es-tu, Sacha ?